4°/ PAIX.
À partir du XIX° siècle, se développe la société moderne, et avec elle de nouveaux rapports humains. L’homme évolue dans sa relation à lui-même et à autrui. La médecine aussi change de rôle. Comme le dit Canguilhem cent ans plus tard, en 1978, : « Des siècles durant, l’activité du médecin avait été la réponse à la prière de l’homme frappé par le mal. Elle est devenue une exigence de l’homme qui refuse le mal ».
La Révolution Française a eu, parmi ses priorités, le souci d’organiser l’Assistance Publique. Ainsi, on assiste à ce paradoxe qui, depuis, n’a fait que croître et embellir : alors que la notion de santé publique ne peut guère trouver d’écho dans les principes de la Médecine Expérimentale ou de l’Ostéopathie, elle s’est imposée à la fois comme réalité vécue et comme projet dans nos sociétés. Bernard disait : « La médecine doit agir sur des individus. Elle n’est pas destinée à agir sur des collectivités, des peuples ». Still ne l’a pas dit comme ça mais est évidemment d’accord sur ce point.
Peu importe ce qu’ils en pensaient, l’idée de santé publique devient la référence médicale.
Ceci, c’est le contexte à ne jamais oublier. Mais je vais plutôt, dans ce chapitre périlleux, essayer de montrer comment certains ont essayé de continuer dans la voie tracée par le Positivisme de Comte, et ainsi pointer certaines parentés de pensée.
Il faut tout d’abord parler de Pierre-Joseph Proudhon. Il est un cas intéressant, moderne produit de la nouvelle société qui vient de quitter brutalement l’Ancien Régime. Autodidacte, c’est en tant qu’ouvrier imprimeur qu’il s’est mis à lire tous les livres qui lui passaient sous le nez. Il est devenu érudit puis a élaboré des théories. Il avait le genre d’esprit qui, durant les siècles précédents, avait mené tant d’hommes, et surtout de femmes, au bûcher ou au fond d’une quelconque Bastille.
Lié à Auguste Comte, il se pose la question de la vie en société et du développement de celle-ci sur les mêmes bases positivistes que Claude Bernard en médecine.
Il observe donc, avant de raisonner, et cherche dans la société l’echo de lois naturelles, afin d’y déceler « un principe tout à la fois d’indépendance et d’organisation, de différenciation et d’unité.
Proudhon part de l’axiome qu’il doit exister des lois régissant l’humanité (le monde, la vie, la pensée) et qu’il faut essayer de les découvrir dans la société elle-même, non de les inventer. Ces lois découvertes, il faut les utiliser intellectuellement comme méthode d’analyse, et pragmatiquement comme méthode d’organisation sociale.
Le monde apparaît comme une pluralité d’éléments irréductibles, à la fois antagonistes et solidaires, d’antinomies, c’est à dire de couples de forces composés d’éléments à la fois antagonistes et complémentaires. Par l’opposition des éléments pris deux à deux, se constitue une succession, une chaîne d’antinomies sans autre lien apparent entre elles que leur rapport antagoniste.
La résolution de l’antinomie est impossible parce que c’est de l’opposition des éléments antinomiques, de leur confrontation réciproque que naissent le mouvement et la vie. La synthèse est donc une vue de l’esprit ; quelque chose de tout à fait artificiel. Elle ne résiste pas à l’épreuve de la vie ou entraîne la mort. En revanche, les termes de l’antinomie peuvent se balancer par le jeu de l’équilibre des contraires, soit terme à terme, soit par opposition avec d’autres couples antinomiques ».
On retrouve ici implicitement le refus de raisonner à partir des a priori du passé. La société d’Ancien Régime était bâtie sur une hiérarchie immuable, la société nouvelle, si elle veut s’inscrire dans la réalité de chacun de ses éléments (c’est le sens profond de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) doit bannir toute hiérarchie a priori.
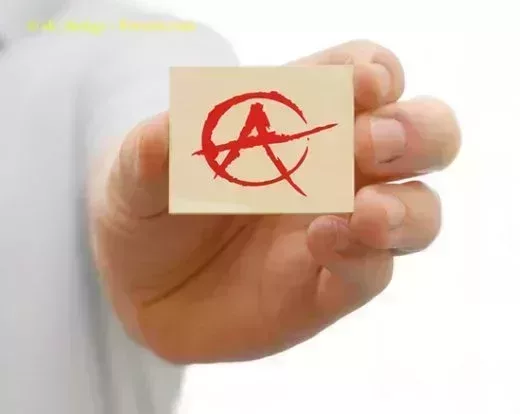
C’est l’Anarchie, dans son sens le plus pur, absence de hiérarchie, qui n’est pas le désordre, loin s’en faut. C’est au contraire la certitude basée sur l’observation qu’il existe un ordre naturel et qu’il faut l’étudier sans a priori, afin de s’en approcher par nos lois.
Voilà ce qu’on peut dire de l’Utopie Républicaine qui traversa le XIX° siècle.
Proudhon est en avance sur son temps, d’environ un siècle. Ce qui est décrit dans ce commentaire introductif à son essai « De la création de l’ordre dans l’humanité » résonne particulièrement avec les découvertes en physique quantique de la fin du siècle dernier. Et sa méthode de raisonnement attendra les années 1960 pour être concrètement utilisée en Sociologie.
Toutes ces belles idées lui vaudront beaucoup de prison, et, après des années de travail en commun, la haine tenace de Karl Marx qui lui reprochait de ne pas faire la synthèse de ces couples antinomiques.
Proudhon préfère enfoncer le clou et moi avec : « Les termes antinomiques ne se résolvent pas plus que les pôles opposés d’une pile électrique ne se détruisent… Ils sont la cause génératrice du mouvement de la vie, du progrès… Le problème consiste à trouver, non leur fusion – ce qui serait la mort – mais leur équilibre, équilibre sans cesse instable, variable, selon le développement même des sociétés ». Encore un petit coup ? « L’antinomie ne se résout pas. Là est le vice fondamental du système de Hegel ». En faisant intervenir artificiellement un troisième terme (synthèse) qu’elle croit faire provenir de la fusion de deux termes du couple antinomique (thèse/antithèse), cette dialectique hégelienne et marxiste conduit sur le terrain politique et social « à l’absolutisme gouvernemental, à la prépotence de l’état, à la subalternisation de l’individu » et sur le terrain idéologique « à la négation de la liberté ».
Armés de ce véritable phare au front, on va pouvoir mieux pénétrer la pensée de Henri Bergson quand il traque le mouvement de l’Évolution.
Après avoir montré que le monde végétal, fait de fixité et d’insensibilité, et le monde animal, avec sa mobilité et sa conscience, divergent à partir d’une souche commune, il s’intéresse, au sein du monde animal, à deux tendances qui s’opposent et se complètent, instinct et intelligence.
L’instinct n’est nulle part aussi abouti que dans le monde des Insectes, et en particulier celui des Hyménoptères. L’intelligence culmine chez les Mammifères (Bergson écrit encore « chez l’homme »).
Laissons-le parler : « …toute l’évolution du règne animal, abstraction faite des reculs vers la vie végétative, s’est accomplie sur deux voies divergentes dont l’une allait à l’instinct et l’autre à l’intelligence. Torpeur végétative, instinct et intelligence, voilà donc enfin les éléments qui coïncidaient dans l’impulsion vitale commune aux plantes et aux animaux, et qui, au cours d’un développement où ils se manifestèrent dans les formes les plus imprévues, se dissocièrent par le seul fait de leur croissance. L’erreur capitale, celle qui, se transmettant depuis Aristote, a vicié la plupart des philosophies de la nature, est de voir dans la vie végétative, dans la vie instinctive et dans la vie raisonnable trois degrés successifs d’une même tendance qui se développe, alors que ce sont trois directions divergentes d’une activité qui s’est scindée en grandissant. La différence entre elles n’est pas une différence d’intensité, ni plus généralement de degré, mais de nature. »
Végétal/Animal, Instinct/Intelligence, sont bien de ces « couples antinomiques » dont parle Proudhon. Mais on est cinquante ans plus tard, la pensée scientifique s’est enrichie depuis Comte, et Bergson, en bon contemporain d’Einstein, pousse son raisonnement vers une étonnante clarté :
« …intelligence et instinct, ayant commencé par s’entrepénétrer, conservent quelque chose de leur origine commune. Ni l’un ni l’autre ne se rencontrent jamais à l’état pur. Nous disions que, dans la plante, peuvent se réveiller la conscience et la mobilité de l’animal qui se sont endormies chez elle, et que l’animal vit sous la menace constante d’un aiguillage sur la vie végétative. Les deux tendances de la plante et de l’animal se pénétraient si bien d’abord qu’il n’y a jamais eu rupture complète entre elles : l’une continue à hanter l’autre ; partout nous les trouvons mêlées ; c’est la proportion qui diffère.

Ainsi pour l’intelligence et l’instinct. Il n’y a pas d’intelligence où l’on ne découvre des traces d’instinct, pas d’instinct surtout qui ne soit entouré d’une frange d’intelligence. C’est cette frange d’intelligence qui a été cause de tant de méprises. De ce que l’instinct est toujours plus ou moins intelligent, on a conclu qu’instinct et intelligence sont choses de même ordre, qu’il n’y a entre eux qu’une différence de complication ou de perfection, et surtout que l’un des deux est exprimable en termes de l’autre. En réalité, ils ne s’accompagnent que parce qu’ils se complètent, et ils ne se complètent que parce qu’ils sont différents, ce qu’il y a d’instinctif dans l’instinct étant de sens opposé à ce qu’il y a d’intelligent dans l’intelligence. »
Comment alors étudier ces « objets » avec une chance d’aller vers la clarification féconde et non vers les complications vaines ?
Toujours pareil, désormais, en incluant le mouvement dans nos observations :
« Disons d’abord que les distinctions que nous allons faire seront trop tranchées, précisément parce que nous voulons définir de l’instinct ce qu’il a d’instinctif et de l’intelligence ce qu’elle a d’intelligent, alors que tout instinct concret est mélangé d’intelligence, comme toute intelligence réelle est pénétrée d’instinct. De plus, ni l’intelligence ni l’instinct ne se prêtent à des définitions rigides ; ce sont des tendances et non pas des choses faites. Enfin, il ne faudra pas oublier que, dans le présent chapitre, nous considérons l’intelligence et l’instinct au sortir de la vie qui les dépose le long de son parcours. Or, la vie manifestée par un organisme est, à nos yeux, un certain effort pour obtenir certaines choses de la matière brute. On ne s’étonnera pas si c’est la diversité de cet effort qui nous frappe dans l’instinct et dans l’intelligence, et si nous voyons dans ces deux formes de l’activité psychique, avant tout, deux méthodes différentes d’action sur la matière inerte. Cette manière un peu étroite de les envisager aura l’avantage de nous fournir un moyen objectif de les distinguer. En revanche, elle ne nous donnera de l’intelligence en général, et de l’instinct en général, que la position moyenne au-dessus et au-dessous de laquelle ils oscillent constamment tous deux. C’est pourquoi l’on ne devra voir dans ce qui va suivre qu’un dessin schématique, où les contours respectifs de l’intelligence et de l’instinct seront plus accusés qu’il ne faut, et où nous aurons négligé l’estompage qui vient, tout à la fois, de l’indécision de chacun d’eux et de leur empiètement réciproque l’un sur l’autre. En un sujet aussi obscur, on ne saurait faire un trop grand effort vers la lumière. Il sera toujours aisé de rendre ensuite les formes plus floues, de corriger ce que le dessin aurait de trop géométrique, enfin de substituer à la raideur d’un schéma la souplesse de la vie ».
Et pour conclure provisoirement :
« Si nous pouvions nous dépouiller de tout orgueil, si, pour définir notre espèce, nous nous en tenions à ce que l’histoire et la préhistoire nous présentent comme la caractéristique de l’homme de l’intelligence, nous ne dirions peut-être pas Homo Sapiens mais Homo Faber. En définitive, l’intelligence, envisagée dans ce qui pourrait être la démarche originelle, est la faculté de fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils, et d’en varier indéfiniment la fabrication.
Maintenant, un animal intelligent possède-t-il aussi des outils et des machines ? Oui, certes, mais ici l’instrument fait partie du corps qui l’utilise. Et, correspondant à cet instrument, il y a un instinct qui sait s’en servir. Sans doute, il s’en faut que tous les instincts consistent dans une faculté naturelle d’utiliser un mécanisme inné.(…) Mais cette définition de l’instinct, comme celle que nous donnons provisoirement de l’intelligence, détermine tout au moins la limite idéale vers laquelle s’acheminent les formes très nombreuses de l’objet défini.
Ainsi, à ne considérer que les cas limites où l’on assiste à un triomphe presque complet de l’intelligence et de l’instinct, on trouve entre eux une différence essentielle : l’instinct achevé est une faculté d’utiliser et même de construire des instruments organisés ; l’intelligence achevée est la faculté de fabriquer et d’employer des instruments inorganisés. »
Henri Bergson présente plusieurs particularités qu’il convient de noter. Né en 1859, mort en 1941, sa vie s’étend sur les deux derniers siècles. Aussi doué en sciences qu’en lettres, il choisit néanmoins la philosophie. Il entre à l’École Normale Supérieure en 1878, dans la même promotion que Jean Jaurès. Professeur agrégé, il occupera une chaire au Collège de France à partir de 1900. Il publie plusieurs remarquables essais dont Le Rire en 1899, et se voit décerner le Prix Nobel de Littérature en 1928. Malgré l’étendue de son œuvre ou peut-être à cause de ça, il n’a pas fait école.
Il a fait beaucoup mieux que ça. Il a compris en direct la transformation qui s’opérait dans la société, ce passage d’un siècle à un autre, et ça l’a amené à observer et théoriser les faits de l’Évolution d’une manière inédite. Une théorie qui, enfin, tranche avec le passé, en ce qu’elle ne pose pas comme a priori la supériorité de l’homme sur tout ce qui l’entoure.
En effet, bien que Lamarck, par ses travaux sur le Transformisme publiés en 1809, eut ouvert la voie en réfutant d’emblée tout finalisme, les premières théories de l’Évolution n’avaient pas vraiment fait varier le point de vue.
Pour simplifier, disons qu’entre l’antique vision religieuse de « l’homme au sommet de la Création » et la sous-interprétation de Darwin contenue dans « l’homme descend du singe », je ne saisis pas vraiment le changement de nature profonde.
Peut-être juste, en comprenant Darwin comme ça l’arrangeait, l’homme s’est-il mis à marcher sur la tête ? C’est ça, j’ai bon ?
Plus sérieusement, Bergson, en réfutant à son tour toute démarche mécanistique − qui calcule l’avenir et le passé en fonction du présent −, et toute démarche finaliste − impliquant que les choses et les êtres ne font que réaliser un programme une fois tracé −, introduit dans ses études le temps, − notion dont on parle dans toutes ces théories incomplètes mais sans jamais en envisager l’action réelle.
Il peut ainsi proposer, comme nous l’avons vu, une théorie divergente de l’Évolution qui va dans le sens du progrès tel que défini depuis le début de ce cours et qui distrait l’homme de sa prétention à occuper la place de Dieu quand il observe la diversité dont il participe.
Son lien avec Herbert Spencer qu’il a maintes fois cité nous ramène à l’Ostéopathie, que nous n’avions jamais quittée. En effet, Still s’est constamment référé dans ses écrits à ce grand penseur de l’Évolution. Peut-être l’a-t-il suivi également quand, en 1898, Spencer tenta de fonder une Ligue contre l’agression pour s’opposer à la guerre hispano-américaine.
On ne s’étonnera pas, en tout cas, de la parenté Spencer-Still quand on lit ce que dit Bergson de son grand aîné américain : « Aujourd’hui encore je me rends compte de ce qui m’attirait chez Spencer, c’était le caractère concret de son esprit, son désir de ramener toujours l’esprit sur le terrain des faits. »
Sa référence à Homo Faber lui aurait sûrement fait apprécier la démarche de Still, mais Bergson n’a pas connu l’Ostéopathie. En revanche, distinguant ce qui, dans la pensée de Spencer révèle l’absence de prise en compte réelle du temps, il a propulsé l’Évolutionnisme vers le 20° siècle, le siècle de la relativité et de l’incertitude.
C’est à cette même époque que l’ostéopathie va connaître sa première et sa plus importante évolution, grâce à William Garner Sutherland.
Durant ses études à l’ASO à Kirksville, en observant les os d’un crâne éclaté, il a l’intuition que les surfaces articulaires sont destinées par leurs contours à une certaine mobilité articulaire. Cette idée totalement incongrue dans le cadre de ce qu’il venait d’apprendre, il ne peut la chasser de son esprit. Il décide alors de prouver… qu’elle est fausse.
On ne s’étonnera pas de la démarche qui rappelle celle de Vésale presque quatre siècles plus tôt. Sutherland, comme son illustre aîné, ne peut remettre en question d’emblée, sur la base d’une simple hypothèse, toutes les théories passées. Il s’agit donc pour lui de démontrer l’immobilité des os du crâne, afin de confirmer ce qui lui a été enseigné, c’est à dire que tous les os du crâne, hormis la mandibule, sont soudés.
Il se met, patiemment, à désarticuler des crânes à l’aide de la pointe d’un canif. Cette approche lente et minutieuse lui révéle la réciprocité des surfaces articulaires, dessinées comme pour favoriser le glissement. Ne pouvant, à partir de ses observations, prouver l’immobilité, il poursuit et fait l’inventaire de chaque os, chaque surface, chaque angle, chaque trou, puis, à l’aide de manuels de mécanique, analyse les gouttières, engrenages, charnières, crochets, poulies, points d’appui et autres dessins qu’il découvre.
À ce point-là de son étude, il est obligé de constater que tout semble constitué pour bouger. Oui, mais ça ne bouge pas. Tous ces mécanismes existent mais ne peuvent servir à rien puisque l’on sait que le crâne est un dôme inflexible.
Sa démarche est bien comparable à celle de Vésale, quand celui-ci, cherchant les voies de passage d’un ventricule à l’autre et ne les trouvant pas, conclut en s’étonnant du travail du Créateur. Mais où donc a-t-il pu cacher ces pores qui existent mais que je ne vois pas ?
Sutherland doit donc prouver l’immobilité. Il met au point une procédure dans ce sens : en empêchant telle « articulation » de fonctionner par une contrainte mécanique, il ne produira aucun effet, ni local ni à distance, puisque cette « articulation » n’est qu’une vue de son esprit, qu’en réalité elle n’existe pas.
Sutherland est, comme son maître Still, profondément religieux. De même que Still est lié à Spencer, Sutherland est très impressionné par la pensée de Walter Russell, un esprit original de ces temps, touche à tout en arts et sciences, philosophe plus ou moins à l’origine de la pensée « New Age », et en tout cas très influent dans l’Amérique de l’entre deux guerres. Lui aussi se place dans la lignée de Spencer, une des figures de proue de son « University of Science and Philosophy ». Un aphorisme représente au mieux sa philosophie : « l’information n’est pas la connaissance »
Contemplant les engins de torture qu’il a fabriqués à l’aide de larges élastiques et de gants de base-ball, afin de contraindre les « articulations » crâniennes, Sutherland décide d’en faire l’expérience sur lui-même. En effet, s’il disposait cet attirail sur un autre que lui, bien sûr, il pourrait récolter une quantité d’informations, mais c’est bel et bien l’autre qui aurait la connaissance.
Alors il expérimente… et il se rend malade.
Bouleversé doublement, il finit par admettre qu’en contraignant sa boîte crânienne, il a bien dû empêcher le fonctionnement d’un mécanisme. Il est donc impossible de conclure à l’immobilité des os du crâne. En vérité, ça bouge.
Il va continuer à expérimenter, s’auto-traitant d’abord, afin d’acquérir la certitude de ne pas nuire, puis traitant des patients à l’aide d’une méthode qu’il peaufine pendant de longues années. Il rend publique sa découverte en 1929. Il s’est passé trente ans depuis sa première intuition, dont vingt ans de mise au point.
Quand il expose sa théorie (qui mettra de longues années à être admise par l’ensemble de la communauté ostéopathique, et encore, c’est pas gagné), il prend bien soin de se référer à Still et de lui attribuer finalement la paternité de cette étonnante découverte.
Ce n’est pas là le signe d’une quelconque « subordination au maître » ; c’est l’expression d’une profonde réalité : en axant l’Ostéopathie sur l’Anatomie, Still a ouvert une voie qui s’enrichit de toute nouvelle trouvaille. Ainsi, chaque nouvelle mise à jour vient confirmer ce que professe l’ostéopathie à la base, l’existence d’une « perfection naturelle » que l’ostéopathe vise à connaître en général et à entretenir en particulier chez son patient.
Il s’est donc passé quelque chose de finalement assez extraordinaire dans ces premières années de développement de l’ostéopathie après la mort de son découvreur.
Alors qu’il s’agit là d’une médecine manuelle, basée sur la pratique d’un homme, quelque chose dont les contemporains de Still pouvaient logiquement penser qu’elle ne lui survivrait pas, non seulement des écoles se créent aux États-Unis, non seulement elle traverse l’Atlantique et s’enseigne au Royaume-Uni, mais en plus elle ne met que quelques dizaines d’années à subir sa première révolution majeure grâce à l’ostéopathie crânienne.
Cette découverte ouvre un champ d’étude gigantesque, d’autant plus que Sutherland avait veillé, juste avant sa mort, à ce que ses premiers élèves n’omettent pas de venir l’enseigner en Europe. Le concept n’intéressant pas trop les britanniques, plutôt attirés par le versant biomécanique de l’ostéopathie, c’est les français qui en hériteront et qui le feront progresser avec l’aide de pionniers américains peu reconnus chez eux.
PETITE NOTICE BIOGRAPHIQUE DE L’AUTEUR.
Je m’appelle Erich Degen, je suis né en 1959 à Paris, de nationalité française. Je suis immigré de la deuxième génération.
Mon père, Joachim Degen, est né à Leipzig en 1926, juif allemand, d’une famille d’artisans fourreurs. Quittant l’Allemagne devenue nazie en 1933, il s’est installé à Paris où il a suivi des études secondaires. La guerre l’a obligé à vivre essentiellement caché ainsi que ses parents. Ma grand-mère Anna Degen, née Zimmermann, a échappé de peu à la déportation suite à la rafle du Vel’ d’hiv. Nombre de cousins, oncles et tantes de mon père sont, eux, repartis vers la Pologne d’où ils étaient issus, pour un obscur voyage dont certains sont revenus, d’autres pas. Il est devenu français par naturalisation au début des années 50.
Ma mère, Estelle Degen, née Goldmer, naquit à Nancy en 1928. Ses parents, juifs polonais, se sont installés en France au début du siècle, fuyant le sport national qu’on appelle pogroms. Elle est donc, comme moi, française immigrée de la deuxième génération. Sa mère, Sara Goldmer, née Steinbuch, oublia qu’elle n’était pas si française que ça, et sortit sans porter son étoile jaune. Dénoncée, elle partit pour Auschwitz en 1942 d’où elle ne revint pas.
Mes parents n’ont jamais parlé beaucoup de cette période devant ma sœur aînée et moi, en tout cas pas des sentiments qui ont pu baigner leurs adolescences respectives.
Intériorisés de la sorte, il n’est pas douteux à mes yeux que ces sentiments me constituent en partie et puissent, à la moindre occasion, s’exprimer par des émotions profondes. Tel je suis.
Et tel je vous propose maintenant ce chapitre intitulé « Guerres » où vous ne serez pas surpris de sentir parfois cette colère ou cet enthousiasme qui amèneront certes de la vie à l’exposé mais nuiront peut-être à son objectivité scientifique.
Il sera temps, une fois Guerres achevé, de dire ce qu’on peut penser, en 2008, de la notion floue d’objectivité scientifique.

